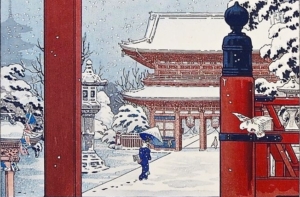Le samurai est une figure légendaire de l’histoire japonaise, pour beaucoup son image s’est construite sur la base de films et de romans au point qu’il est difficile de faire la part de l’invention et de l’histoire. Il en découle une image stéréotypée des samurais, principalement liée aux souvenirs de l’époque Edo (XVII-XIXe siècles) et qui ignore souvent que les samurais ont existé et évolué durant presque un millénaire sous des conditions très variées. Peut-on tordre le coup à quelques mythes liés aux samurais?
Le samurai restait fidèle à son seigneur jusqu’à la mort.
Qui connaît un peu le Japon a déjà entendu parler de la voie du guerrier, le bushidô, sur lequel beaucoup d’idées reçues et de fantasmes se sont greffés pour former notre imaginaire collectif sur les samurais. La principale de ces idées reçues est d’affirmer que les samurais se devaient d’être entièrement fidèles à leur seigneur et qu’ils préféraient mourir plutôt que de le déshonorer. C’est en fait une idée qui s’est répandue après la fin de l’époque des samurais, quand on regarde l’ensemble de l’histoire des samurais, l’idée de fidélité était toute relative et avait ses limites. A l’époque Kamakura (1192-1333) la fidélité (Chû) et le service (Hôkô) du vassal pour le toryô, le suzerain, était étroitement lié de la récompense (On), en terres ou en butin, que celui-ci accordait au vassal. La chute du shogunat de Kamakura en 1333 siècle fut justement provoquée par l’incapacité du bakufu à récompenser ses gokenin, ses vassaux, ou à protéger leur prospérité. S’estimant mal récompensés, spoliés et méprisés, les gokenin firent la guerre pour leur propre compte et finirent par trahir au profit d’un rival capable de les récompenser : l’empereur Go-Daigo puis, quand il s’en révéla incapable, Ashikaga Takauji. Aucune infamie n’était attachée à ce renversement puisque le seigneur qui récompensait mal son vassal montrait la limite de sa générosité, ce qui rompait le lien vassalique.

A la période suivante l’idée de fidélité envers le seigneur commença à se développer, les relations entre le suzerain et le vassal avaient évolué sur la base de relations plus personnelles et moins contractuelles, les premiers codes du guerrier font leur apparition. L’époque Muromachi fut cependant marquée par des fidélités contradictoires : les luttes entre les deux cours impériales, entre les différents prétendants à la fonction de shogun, luttes de succession au sein même des grandes familles. Un samurai de cette époque était presque inévitablement amené à choisir entre plusieurs fidélités, un choix qui faisait naturellement intervenir l’intérêt personnel, sans compter la fidélité à sa propre famille et à l’amitié de ses alliés. Durant les guerres civiles du Sengoku Jidai, la trahison était omniprésente chez les samurais et se marchandait sans honte si elle se justifiait par le profit ou la survie. Tokugawa Ieyasu n’aurait jamais remporté la bataille de Sekigahara s’il n’avait pas pris la peine de corrompre et d’attirer à lui ses ennemis apparents, durant la bataille près de 23 000 hommes changèrent de camp à son avantage et en furent récompensés sans paraître déshonorés.

C’est cependant à la même période qu’apparaît l’idée d’une fidélité extrême au seigneur. Cette fidélité était basée entièrement sur le prestige et le charisme personnel du seigneur, le Kiryô no Jin. Cette fidélité au charisme du seigneur menait à une fidélité allant jusqu’au junshi, le suicide pour accompagner son seigneur dans la mort. Cette fidélité avait ses limites, elle n’était attachée qu’à la personne du seigneur, pas au clan ou à ses héritiers, le passage à la génération suivante entraînait souvent des changements de camps si l’héritier n’était pas capable d’affirmer ses compétences et choyer les vassaux de son père. C’est ainsi que les généraux du célèbre Takeda Shingen de Kai n’hésitèrent pas longtemps avant de trahir son fils Katsuyori et négocier leur ralliement à Oda Nobunaga (lui-même fut trahi et tué par un de ses généraux).

Quand Tokugawa Ieyasu devint le maître du Japon, il entreprit de corriger les excès de cette période et de mettre au pas les guerriers. Il fallait normaliser les relations entre seigneur et vassal, cela passa par la promulgation du Buke Shohattô de 1615 qui décrivait précisément les devoirs et l’éducation des guerriers. Cette éducation fut basée sur l’idée d’un code du guerrier, qui existait déjà, mais qui fut étendu, affirmé et formalisé, la plupart des clans japonais adoptèrent en interne des codes semblables. La fidélité et le service furent promus comme principes fondamentaux du guerrier mais cette fidélité était due au clan et non plus seulement au seigneur. Cette distinction permettait de donner aux vassaux la capacité de distinguer entre l’intérêt de leur maître et l’intérêt supérieur du clan (c’est-à-dire la famille du seigneur mais aussi l’ensemble de sa vassalité). La pratique du junshi fut progressivement interdite et sévèrement punie à partir du règne de Tokugawa Iemitsu. Les Tokugawa parvinrent à domestiquer les samurais au-delà de leurs espérances au point que le récit des 47 rônins d’Ako au début du XVIIIe siècle apparut comme une relique d’un passé héroïque.

Les samurais du seigneur d’Ako s’étaient retrouvés sans maître après la condamnation de leur seigneur (Asano Naganori) et la confiscation de son domaine, ils en avaient tiré vengeance en exécutant l’homme (Kira Yoshinaka) jugé responsable de cette condamnation. Les rônins d’Ako devinrent le symbole nostalgique d’une époque révolue de guerriers héroïques mais leur action allait à l’encontre du bushidô car elle ne relevait que la vengeance personnelle et oubliait la fidélité due au clan et à leurs familles. Cette nostalgie guerrière n’était pas un phénomène isolé et touchait la plupart des domaines. Au début du XVIIIe siècle, un samurai du domaine de Saga, Yamamoto Tsunemoto, rédigea un pamphlet après avoir été empêché d’accomplir le junshi. Son livre, le Hagakure, exposait une idéologie jugée tellement extrême pour son époque qu’il fut interdit et détruit sur ordre du daimyô de Saga. Cette idéologie se résumait à l’idée que la mort au service du seigneur devait être la finalité ultime du guerrier. Il s’agissait d’une relecture dans un sens auto-destructeur du bushidô qui était loin de correspondre à la norme de l’époque et reconstruisait un passé fantasmé puisant dans les souvenirs du Sengoku Jidai. Le Hagakure est encore à la base d’une partie de notre imaginaire lié au bushidô. L’ouvrage fut redécouvert au début du XXe siècle et devint rapidement le modèle à suivre pour les officiers nationalistes de l’armée impériale japonaise, l’empereur remplaçant le seigneur comme objet de la fidélité du guerrier. Dans les années 30, la faction Kôdôha de l’armée se basait ainsi sur une idéologie qui encensait l’esprit du samurai, indoctrinant des milliers de jeunes officiers dans une vue fanatisée de la force morale du guerrier capable de surpasser les tous les obstacles et sa fidélité jusqu’à la mort.
On sait quels dégâts fit cette reconstruction tardive et tronquée du code du guerrier, elle aurait consterné les véritables samurais. La fidélité était bien un principe fondamental des guerriers mais ce principe s’imposa très tardivement à l’époque Edo et se limitait à une fidélité au clan et à la famille.
Le samurai était prêt à se faire Harakiri pour laver le déshonneur.
Ce mythe est souvent lié au précédent, l’idée que les samurais étaient prompts à se punir d’un manquement, notamment envers leur seigneur, par le suicide rituel est encore très présente. Le mot « Harakiri » lui-même n’existe pas au Japon, il s’agit d’une mauvaise lecture des kanjis du mot seppuku, mais l’idée reste, il s’agit de se couper (kiri) le ventre (hara). Le suicide chez les guerriers est bien attesté mais pendant longtemps il n’était pratiqué qu’en cas de défaite lors d’une guerre ou bien à la suite d’une condamnation contraignante. Ainsi en 1180, après sa défaite lors de la bataille d’Uji, Minamoto no Yorimasa est considéré comme un des premiers exemples de suicide guerrier. Nous avons vu que l’idée de prendre sa vie pour suivre la mort de son suzerain, le junshi, existait mais elle ne fut réellement pratiquée qu’aux XVIe-XVIIe siècles. Le rituel lui-même du seppuku resta longtemps non codifié et dépendant des circonstances. Le seppuku commença à prendre sa forme classique à partir de l’époque Muromachi mais surtout à la fin du Sengoku Jidai, les guerres civiles elles-mêmes ne laissaient souvent pas le loisir d’organiser une cérémonie aussi complexe. La possibilité de prendre sa vie en dehors du cadre de la guerre commença à être sciemment limité par les daimyôs à la fin du XVIe siècle. Cela correspondait au contrôle grandissant des seigneurs sur leurs vassaux dans un cadre plus hiérarchique et au début de la mise en ordre de la classe samurai.
Cette mise en ordre fut poursuivie et achevée avec le bakufu des Tokugawa durant laquelle le seppuku pris sa forme rituelle. Durant la paix de l’époque Edo, l’absence de guerre éradiqua la première cause de seppuku, le suicide rituel devint presque exclusivement lié à la punition des fautes. Le samurai ne prenait pas sa vie de sa propre initiative pour laver son honneur mais était condamné à mort après une procédure. Il bénéficiait ainsi d’un privilège de classe sous la forme d’une condamnation à mort honorable qui leur était réservée, de la même manière les nobles européens étaient les seuls à avoir le privilège d’être décapités et non pendus comme tout le monde. Il y avait donc une contrainte dans le seppuku, les cas de suicide spontané par seppuku étaient rares, par exemple le junshi, mais ce dernier avait totalement disparu à la fin du XVIIe siècle.

Le geste du seppuku consistait à s’ouvrir le ventre avec sa lame courte wakizashi, cette manière de faire était particulièrement douloureuse et le condamné bénéficiait de l’aide d’un assistant, le kaishaku, une personne de confiance chargée de décapiter le suicidé au premier signe de défaillance. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles la tendance alla vers une décapitation de plus en plus rapide afin d’épargner la partie douloureuse ou éviter de faire perdre la face. Dans les premiers temps, il suffisait de se percer le ventre pour voir automatiquement ses souffrances abrégées, les samurais en vinrent à se contenter de prendre leur lame en main, voir de faire le geste de la prendre avant d’être achevés. Au XVIIIe siècle, on recourrait de plus en plus à l’Ôgibara où la lame était remplacée par une lame de bois ou un éventail pour mimer le geste du suicide et être achevé. Avec l’ôgibara, le seppuku devenait de plus en plus une fiction, il servait aussi de condamnation atténuée qui pouvait se négocier s’en engendrer de perte d’honneur pour la famille du condamné. Dans un sens opposé, le condamné pouvait insister pour accomplir le geste complet, jusqu’à sortir soi-même ses viscères, ce type de seppuku était qualifié de Munenbara, de seppuku de protestation. Ce fut le cas par exemple des samurais de Tosa qui avaient tué de marins français lors de l’incident de Sakai en 1868 et qui insistèrent pour s’ouvrir réellement le ventre. Le suicide, même exigé par une condamnation, devenait alors une forme de protestation ou une manière d’affirmer une opinion. Le Munenbara était souvent mal vu par les autorités qui y voyaient un défi à leur justice, il pouvait entraîner des conséquences néfastes pour la famille survivante.

C’est cependant cette forme qui subista à la fin de l’époque des samurais en 1868. Avec la fin de la classe des samurais, le seppuku en tant que forme de punition exclusive des guerriers disparut. La seule utilisation du suicide rituel devint alors une forme de protestation que le suicidé s’imposait volontairement, l’exemple le plus célèbre étant l’écrivain Mishima Yukio en 1970. Durant la période de l’impérialisme japonais, la lecture d’un bushidô réécrit et fantasmé amena à un retour des suicides en cas de défaite ou du junshi mais ces pratiques cessèrent après 1945. Dans tous les cas de figures nous voyons que le seppuku servait toujours une fonction : justice, protestation, punition de la défaite, mais était rarement un acte volontaire lié à une perte d’honneur.
Le samurai avait un droit de vie et de mort sur les paysans.
On peut avoir un aperçu de ce mythe en regardant le Dernier Samurai (Edward Zwick, 2003). Dans une scène particulière, un samurai insulté par deux Japonais, portant des vêtements occidentaux, tranche calmement la tête de l’un d’eux avant de poursuivre son chemin. Ce mythe ne repose pas sur une invention puisque les samurais de l’époque Edo avaient réellement le droit de tuer de leur sabre un importun qui les auraient insulté. Ce droit était appelé le Kirisute gomen et devait permettre aux guerriers de forcer le respect du peuple par la crainte. Dans les faits cependant, ce droit était moins facile a appliquer que dans les films hollywoodiens, il ne suffisait pas de sortir son sabre si quelqu’un vous regardait de travers. En cas de Kirisute gomen, le samurai devait se présenter volontairement aux autorités et produire des témoins attestant qu’il y avait eu insulte publique et que la punition avait été immédiatement administrée, une punition différée ou sans témoin transformait l’acte en simple meurtre. Il y avait une réaction judiciaire des autorités shogunales qui devaient se prononcer sur le bien fondé de l’acte, durant le temps de cette réaction le samurai devait être tenu aux arrêts. Cette procédure contraignante faisait partie de l’ensemble des mesures prises par les Tokugawa afin de pacifier les mœurs guerrières, les samurais avaient le droit de faire peur mais pas plus.

Dans les faits il n’existe pas d’exemple attesté de Kirisute gomen en plus de deux siècles de pouvoir des Tokugawa, à aucun moment. Il y a plusieurs raisons à cela, il y a bien sûr l’embarras procédurier que cela aurait provoqué mais pas seulement. L’époque Edo avait vu se développer de plus en plus une classe marchande urbaine et très puissante qui vendait, prêtait et commercçait avec la plupart des domaines seigneuriaux et le shogunat. Au début du XVIIIe siècle les changeurs de riz d’Edo et Osaka représentaient des puissances non négligeables. Dans le même temps une partie croissante des samurais de bas rang se retrouvaient dans des situations financières difficiles causées par des dépenses de prestiges obligatoires et l’inflation. Durant la majeure partie de l’ère Edo, les samurais vécurent avec le fait qu’une partie des « gens du peuple » étaient plus riches et influents qu’eux, totalement hors de leur portée. Au cours du XVIIIe siècle, l’image du samurai se modifia en conséquence, en particulier à Edo où apparut l’image du samurai traîne-sabre, vantard, endettés et lourdaud, exprimant l’idée de yabo, de vulgarité, opposé à la sophistication des gens des villes. Poèmes satyriques et pièces comiques ne manquaient de véhiculer cette image et les témoignages ne manquent pas montrant des samurais publiquement et ouvertement moqués par des passants. Il devenait difficile pour le samurai d’appliquer son droit au Kirisute gomen dans des conditions où il était souvent brocardé et où toute réaction violente n’engendrerait que le mépris et la moquerie, en plus de l’hostilité des autorités. Jusqu’à la fin de l’époque Edo la figure du samurai, bien que socialement dominante avait cessé d’être un modèle admiré et le Kirisute gomen représentait un privilège de prestige difficile à appliquer.
Le samurai était un guerrier.
Cette affirmation peut paraître bizarre, il est universellement connu que les samurais étaient des guerriers, des chevaliers du Japon. Ce n’est cependant pas le sens du mot lui-même qui dérive du verbe samuru et signifie serviteur (du seigneur). Les termes désignant les guerriers étaient nombreux mais peuvent être réduits à musha ou bushi qui signifient plus précisément celui qui vit par les armes. La distinction est cependant utile puisque dès leur origine les samurais ne se concevaient pas uniquement des hommes d’armes mais comme des hommes au service d’un autre. A la fin de l’époque Heian, les premiers samurais étaient surtout des propriétaires terriens de domaines disposant d’hommes de mains armés ou devant un service militaire à un patron, la fonction militaire dérivait du besoin de protéger son bien. Durant toute la période allant de l’ère Kamakura au début de l’ère Edo il continua à exister des catégories de petits samurais attachés à la terre, cultivée par des serviteurs ou directement par le guerrier, on parlait alors de jizamurai (samurai de la terre). A l’époque des guerres civiles un grand nombre de soldats de pied, qui n’étaient à proprement parler des samurais et étaient connus sous le nom d’ashigaru, n’exerçaient le métier des armes qu’épisodiquement lors des campagnes ou pour le service de garde.
Durant l’époque Edo le détachement de la fonction militaire se fit encore plus net. Le bakufu des Tokugawa avait voulu affirmer la fonction militaire, au service du domaine, pour en faire l’élément définissant la classe samurai symbolisé par le port des sabres. Le samurai, le serviteur de son seigneur, devait un service de garde pour son maître, devait être prêt à la mobilisation et devait s’entretenir par un entraînement martial quotidien. La période Edo était cependant marquée par l’absence notable de guerres justifiant l’entretien de troupes de guerriers en temps de paix, les daimyôs durent trouver une utilité à leurs vassaux. Ils en firent des fonctionnaires des domaines, scribes, gardes, conseillers, percepteurs, intendants et inspecteurs des champs et des ouvrages etc. La place des samurais se définissait par leur fonction et leur utilité pour le domaine et était récompensée par un salaire, la fonction purement militaire, bien que proclamée et vantée, devenait dans les faits de plus en plus théorique.
A cela s’ajoute le fait que tous les samurais n’étaient pas égaux, les vassaux directs et les conseillers des daimyôs vivaient avec une certaine sécurité financière et pouvaient se permettre de se consacrer à leurs vertus martiales, il n’en était pas de même pour tous. Les catégories les plus basses des samurais, issus des ashigaru, étaient détachés des terres et ne subsistaient que grâce à leur salaire au service du daimyô. Ce salaire pouvait être inférieur aux besoins d’une famille, estimé à 4 koku, des salaires inférieurs jusqu’à 2 koku existaient, par comparaison le statut de daimyô impliquait un revenu minimum de 10 000 koku. Cette classe de petits samurais était contrainte à des dépenses de prestige comme des kimonos convenables, leurs armes et leur armure. L’inflation croissante de l’époque Edo les laissaient souvent dans des difficultés financières. Pour cette raison cette catégorie de samurais était autorisée à pratiquer des activités artisanales destinées à la revente. Le plus souvent c’étaient les femmes de la famille qui se chargeaient de ces travaux pour le compte d’un propriétaire qui récupérait la production. Il n’était pas rare que cette activité secondaire finisse par représenter l’essentiel des revenus de la famille et impliquer les hommes. Iwasaki Yatarô, samurai fondateur de Mistubishi venait d’une famille qui vendait du bois de charpente, Shibusawa Eiichi, autre homme d’affaire de l’ère Meiji, venait d’une famille cultivant l’indigo. Les exemples sont nombreux et paradoxalement ce sont ces catégories qui s’en sortirent le mieux avec la fin de l’époque des samurais : ils disposaient d’un savoir faire, d’une débrouillardise et d’une volonté de s’élever qui fut stimulée par l’indemnité de 5 ans de salaire versée par le gouvermenent à tous les anciens samurais après l’abolition des fiefs en 1871. La catégorie des samurais n’avait jamais constitué une classe sociale cohérente et les arts de la guerre, bien que les définissant, étaient loin d’être leur seul activité.

Les rônins étaient des guerriers vagabonds.

Nous avons tous en tête l’image du rônin, le samurai sans maître, solitaire parcourant les chemins du Japon en redresseur des torts comme le cinéma japonais a si bien su le présenter, la réalité était un peu différente. Durant l’époque Muromachi et surtout le Sengoku Jidai, être un rônin n’était pas spécialement rare, les guerres continuelles voyaient disparaître des clans dont les guerriers se retrouvaient sans emploi et à la recherche d’un nouveau maître. Etre rônin était alors vu comme une phase entre deux emplois, pas une situation permanente ni même embarrassante. Au tout début de l’époque Edo, Toyotomi Hideyori n’avait eu que l’embarras du choix pour recruter des rônins de tout le pays pour lutter contre Tokugawa Ieyasu, il y avait des places à prendre et des récompenses à gagner. C’est justement après la prise du château d’Osaka en 1615 et la victoire finale des Tokugawa sur les Toyotomi, que la situation changea radicalement.
Nous avons vu à plusieurs reprises que le nouveau shogunat entendait domestiquer les guerriers en redéfinissant leur rôle premier comme étant des serviteurs d’un maître à qui ils devaient un service exclusif. Le samurai se définit alors par l’appartenance à un domaine, qui n’entrait pas dans cette définition se trouvait de fait hors du système conçu par le shogunat. La fin des guerres civiles rendit de plus en plus difficile la possibilité de retrouver une place ailleurs, d’autant plus que les Tokugawa obligèrent les daimyôs à réduire les effectifs de leurs armées privées. La situation du rônin passa de temporaire à permanente, elle s’accompagna d’une marginalisation de la société, le guerrier sans maître n’était par définition plus un samurai mais un dangereux marginal armé. Dans la première moitié du XVIIe siècle ces rônins constituèrent une menace latente pour les autorités, ils posaient des problèmes de sécurité et étaient prompts à comploter dans l’espoir de provoquer des troubles qui leur permettraient d’améliorer leur situation. En 1637 ils furent nombreux à rejoindre les rangs des rebelles de Shimabara et en 1651 le rônin Yui Shôsetsu organisa une véritable conspiration dans le but de renverser le shogunat et provoquer une guerre civile.

Ces deux évènements furent l’occasion pour les autorité pour faire la chasse aux rônins et, l’âge aidant, leur nombre diminua drastiquement dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il existait encore des rônins ensuite mais dans la majorité des cas il s’agissait de samurais déchus qui avaient perdu leur rang pour une faute ou par leur incapacité financière à tenir ce rang. Dans la très grande majorité des cas ces personnes ne présentaient pas le profil du loup solitaire vivant de son sabre, une telle personne aurait eu tôt fait de s’attirer la suspiçion des autorités. De manière plus pragmatique la plupart des rônins du XVIIe siècle se fondirent dans la masse des gens du peuple en prenant un travail et se reconvertissant, une fois avalée la honte de la perte du statut.
D’où vient alors l’image du vagabond expert du sabre de nos films ? Il s’agirait probablement de la confusion avec une autre situation, le musha shugyô, à la fois pèlerinage et entrainement itinérant que pouvait choisir d’accomplir un spécialiste du maniement des armes et qui le poussait à visiter d’autres écoles et gagner de l’expérience sur une période couvrant parfois plusieurs années.
Au-delà de l’image du samurai véhiculée dans la culture populaire, nous pouvons voir que les samurais ne constituèrent jamais une classe sociale homogène ou même ayant les mêmes intérêts. Leur situation évolua grandement durant le millénaire où il existèrent, les guerriers bravaches de la fin de l’époque Heian ou du Sengoku Jidai n’avait plus guère à voir avec les stoïques samurais de l’époque Edo. Etre samurai recouvrait une très grande variété de situations et conditions.